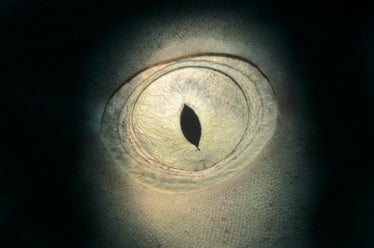
À quoi tient l’obéissance ? À quoi tient la civilisation ? Pour Thomas Hobbes, tout part d’une seule et même chose : la peur de mourir. Cette idée, développée dans son œuvre monumentale Le Léviathan (1651), trouve un écho troublant dans notre époque. C’est ce que démontre avec finesse Jean-François Caron dans un échange dense et percutant, où Hobbes devient notre contemporain.
Hobbes naît en 1588 dans une Angleterre en pleine effervescence religieuse et politique. Marqué par la guerre civile anglaise (1642–1651), il assiste à l’effondrement de l’autorité, au chaos des combats entre royalistes et parlementaires, et à l’exécution du roi Charles Ier. Ce contexte violent façonne sa philosophie : pour lui, l’état de nature – c’est-à-dire un monde sans État – n’est pas une abstraction, mais une réalité vécue, brutale, désorganisée, où chacun devient une menace pour l’autre. L’homme y est un loup pour l’homme, prêt à tuer pour survivre.
De ce constat émerge la nécessité d’un pacte : un contrat social par lequel les individus renoncent à leur liberté naturelle en échange de la sécurité garantie par un souverain. Ce souverain, c’est le Léviathan – l’État tout-puissant, doté du monopole de la violence légitime. Mais Hobbes innove : il ne fonde pas cette autorité sur Dieu, mais sur la raison humaine, sur l’intérêt bien compris de chacun. En cela, il se démarque des monarchies de droit divin et propose une justification laïque du pouvoir absolu : si l’homme veut éviter la mort violente, il doit se soumettre à une autorité forte, capable de trancher et d’imposer l’ordre.
Ce réalisme anthropologique – hérité de Machiavel – est sans concession. L’homme n’est ni bon ni moral ; il est guidé par la peur, le désir de vivre, et sa capacité à nuire. Et cette capacité est universellement partagée : le faible, par la ruse, peut tuer le fort. Cette égalité dans la menace justifie l’invention du droit, non comme idéal moral, mais comme moyen de survie. « Fear and I were born twins », écrit Hobbes. La peur est à la fois le fondement de l’obéissance et le moteur de la révolte : on se soumet par crainte du chaos, mais on se rebelle si le souverain devient lui-même une menace pour notre vie.
Cette mécanique hobbesienne, apparemment lointaine, éclaire de manière saisissante certains réflexes contemporains. Le podcast souligne trois moments clés où la peur collective a poussé les citoyens à réclamer plus de contrôle : les attentats du 11 septembre, la pandémie de COVID-19, et la crise climatique. Dans chacun de ces cas, la peur de mourir – ou de voir ses proches mourir – a généré une pression populaire pour des restrictions accrues. Ce n’est plus seulement l’État qui impose la répression : ce sont les citoyens eux-mêmes qui réclament la mise en place de chaînes, de lois, de limites à leurs propres libertés, au nom de la sécurité.
On assiste à une sorte de néo-hobbisme populaire, où les foules manifestent pour être mieux encadrées, mieux surveillées, mieux protégées – quitte à céder toujours plus de leur autonomie. La sécurité devient la valeur suprême, la vie biologique le seul horizon. Le problème, souligne Caron, c’est que plus on offre de sécurité, plus on en réclame. Un engrenage se met en place, où la liberté devient une menace. Et l’État, tel le Léviathan, s’impose de plus en plus comme le seul garant de notre existence.
Cette tension entre liberté et sécurité, Hobbes l’avait déjà formulée avec une clarté glaçante. Il écrivait que les lois civiles sont comme des chaînes artificielles : elles ne tiennent pas parce qu’elles sont solides, mais parce qu’il est dangereux de les briser. C’est la peur de la punition – et non l’amour de la vertu – qui fonde la société. Une vision sombre, certes, mais qui explique pourquoi l’État ne peut jamais se permettre d’être faible, et pourquoi toute crise majeure relance inévitablement la demande d’un pouvoir fort, centralisé, réactif, unifié.
L’échange se conclut sur cette dérive : lorsque la peur devient irrationnelle – peur du terrorisme, peur de la chaleur, peur de la viande ou du CO₂ –, elle ouvre la voie à une infantilisation collective, où les citoyens exigent qu’on leur dicte comment vivre pour ne pas mourir. L’État devient alors non plus un gardien de l’ordre, mais une autorité parentale, qui interdit les bouteilles d’eau, les chaises longues, les stores verticaux, au nom de la sécurité totale.
Le Léviathan de Hobbes n’a donc jamais été aussi vivant. Dans un monde où la peur façonne les politiques publiques et les comportements individuels, sa pensée nous oblige à poser la question essentielle : à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour vivre ? Et jusqu’où l’État peut-il aller, sans devenir lui-même une menace pour ceux qu’il prétend protéger ?


Ajouter un commentaire
Commentaires